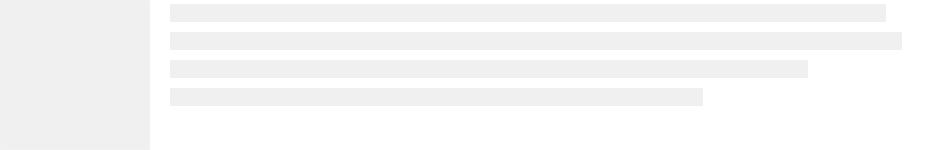Le hipsterisme, sous-culture dominante en Amérique du Nord, brise de plus en plus les frontières géographiques. Dans de telles conditions, essayer de définir cette culture marginale devient presque impossible. Pourtant, quelques dizaines d’années après l’apparition des premiers hipsters aux États-Unis, on commence à s’interroger sur ce phénomène social tentaculaire.
« On est tous le hipster de quelqu’un d’autre. » Voilà comment Daniel Grenier, doctorant en études littéraires à l’UQAM abordait la question lors d’une conférence nommée On achève bien les hipsters; une autofiction, en janvier 2012. C’est vrai que, selon le regard de chacun, le hipster change d’apparence. En passant par le geek qui s’habille chez American Apparel, la jeune fashionista qui court les friperies vintage branchées et le serveur de café tatoué, portant les jeans serrés et les lunettes en plastique surdimensionnées, le hipsterisme a le dos large.
Contrairement à d’autres sous-cultures mieux définies, comme la culture punk, noire ou hip hop, les codes du mouvement hipster restent flous. Dans What was the hipster? A sociological investigation, l’équipe du journal new-yorkais n+1 relatent les résultats d’un forum ouvert au public, tenu en 2009, qui visait à élucider le mystère entourant le hipster. L’essai suppose que la sous-culture hipster, qui aurait débuté à la fin des années 1990, est en train de disparaître pour être diluée dans la culture de masse. Conscients qu’il est risqué d’étudier un phénomène social dans lequel ils sont à la fois acteurs et spectateurs, les panelistes avancent leurs idées.
Parmi les définitions proposées dans What was the hipster?, on s’entend pour attribuer à cette figure culturelle un code vestimentaire issu de la jeunesse blanche américaine des années 1950 (jeans « skinny », lunettes de type aviateur, casquette de camionneur, camisole blanche, bière Pabst Blue Ribbon, etc.), une attitude blasée, un usage abusif de l’ironie comme humour et une profonde nostalgie de l’enfance.
Les auteurs de l’ouvrage parlent du hipster comme de cette « personne qu’on ne peut classer dans un aucun groupe (l’artiste ou l’étudiant affamés, le néo-bohémien, le vegan, le cycliste ou le skatepunk), qui est à la fois membre de la sous-culture rebelle et de la classe sociale dominante, et qui ouvre un passage empoisonné entre ces deux dimensions ». De ce constat émane le principal reproche qu’on attribue au hipster : comme il est généralement issu d’un milieu aisé, il n’entretient un côté rebelle ou réfractaire que par désir d’être « cool » ou « branché », sans revendiquer quoi que ce soit.
C’est cette absence de revendication, élément central à toute sous-culture, qui caractérise avant tout le hipsterisme. Cool pour être cool. C’est non seulement la première sous-culture à être massivement distribuée via les nouveaux médias de masse et les réseaux sociaux, mais c’est aussi la première fois que des symboles d’une culture marginale sont récupérés aussi vite par les compagnies de marketing. Le consumérisme qui touche la mode hipster noie l’essentiel de ce courant culturel. C’est de la poudre aux yeux.
Joëlle Gauthier, assistante de recherche et étudiante au doctorat en études littéraires à l’UQAM se penche aussi sur le phénomène hipster, mais à partir de la mouvance « beatsters », qui s’inspire de la « beat generation » américaine. Ses recherches tentent de réduire le hipster au strict minimum, à partir de l’histoire et des grands mythes populaires des États-Unis. D’après Gauthier, le « hip » se définit comme étant le savoir secret, codifié et unique à chaque contre-culture. C’est l’élément de distinction qui permet à un groupe dominé de se protéger, ou d’en avoir l’illusion (par exemple, le hip noir, serait apparu pendant l’époque esclavagiste américaine).
Plus les sous-cultures se multiplient et plus le hip se diversifie, s’amenuise. Pour Joëlle Gauthier, les hipsters contemporains, devant cette économie du hip, « ont érigé autour des signes du hip, tout ce qui définit la posture cool, qui établit cette essentielle distance entre l’autre et soi, ce qui s’apparente à un véritable culte ». Ce qui explique, d’une certaine façon, pourquoi les hipsters repoussent souvent la limite de leurs connaissances culturelles dans des domaines toujours plus pointus, pour essayer de se distinguer de la masse et recréer cette supériorité individuelle protectrice. Un constat que fait aussi Daniel Grenier dans On achève bien les hipsters; une autofiction : « C’est d’ailleurs ce qui est passionnant avec le style tel qu’investi par les hipsters : contrairement à n’importe quel autre sous-culture qui restera toujours en marge, il s’imposera et deviendra la norme, dans ses aspects les plus clichés du moins. »
Comme quoi, dans une société toujours plus individualiste, les revendications communautaires ou culturelles, propres à une contre-culture, font davantage place aux valeurs de distinction individuelle ou groupusculaire. Le hipster pourra toujours se comparer aux autres en jugeant, en faisant appel à l’ironie au point où, pour la première fois dans le monde des sous-cultures, le marginal sera récupéré par un plus grand public.
D’après Joëlle Gauthier, bien qu’on puisse comprendre le mouvement hipster américain à partir de l’histoire des États-Unis, n’est pas hipster qui le veut. Et même si le capitalisme a compris que « le style hipster, même s’il témoigne localement d’un riche complexe national mythique encore non résolu, se commercialise extrêmement bien à l’extérieur de son lieu de naissance, [mais] il ne suffit pas d’ironiser et de porter le jeans, les lunettes et les bottes en mode vintage pour se créer hipster ».
Alors il existe de vrais hipsters, qui forment une contre-culture avec des valeurs, des idéaux et qui s’organisent en communauté? Pour Gauthier, absolument. « Il y a toujours une énorme différence entre la base contre-culturelle d’un mouvement, composée des purs et durs, et la version édulcorée de celui-ci, en vente dans les boutiques à la mode, explique-t-elle. Et les mécanismes de sociabilité en place dans le Western Massachusetts ne laissent aucun doute : la communauté hipster (et surtout, la communauté littéraire hipster) existe! »
En effectuant un travail de recherche sur le terrain, au sein des communautés « beatsters » de l’axe Northampton-Brooklyn, Joëlle Gauthier a pu jeter les fondations d’une définition plus humaine du phénomène social hipster :
« En gros, le mouvement de base hipster, dans sa forme underground, c’est un vaste réseau de jeunes bourgeois blancs fraîchement diplômés qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui ont opté pour la bohême, le temps de trouver un sens à tout ce qui se passe autour… Les traumatisés du post-09/11. Ils ne veulent pas les gros emplois, ils ne veulent pas le modèle offert par leurs parents, ils ne veulent pas la guerre en Irak, mais ils ont de la difficulté à trouver des options. Et ça les angoisse terriblement. Alors ils se tournent vers le hip, vers Walt Whitman, vers les vieilles machines à écrire mécaniques, vers les trucs vintage, vers les soirées de poésie comme on en voyait dans les années 1950, et ils se referment sur eux-mêmes et se racontent leur propre vie entre eux. Dans le fond, c’est très beau et plutôt tragique. »
Mais il est aussi vrai, admet Joëlle Gauthier, que le hipsterisme crée des micro-communautées. Les grands projets de société, la grande communauté englobante seraient peut-être en train de disparaître, au profit de petits regroupements, encore jeunes, d’individus en jeans, lunettes et bottes rétros.